
ou sur le " sentimentalisme" de
Barrie...
[en cours d'écriture...]
La couleur de notre site semblera, au prime abord, féminine
et sucrée. Certes, mais elle répond aussi à
une idée que j'espère plus subtile. Elle n'est pas
simplement une couleur qui me plaît trop. La guimauve est
traditionnellement associée dans notre langue à
une forme de sentimentalisme de mauvais aloi, à un caractère
ou à des émotions faussement imbus d'eux-mêmes.
Or, telle est souvent la perception fausse que certains ont de
J.M.B. et de son oeuvre. J'aimerais donner des éléments
pour contrebattre ce préjugé.

Barrie emploie sans gêne le mot de
sentimental. Un de
ses romans est affublé de l'adjectif, Sentimental Tommy.
Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot sentimental.
Prenons le Roget’s Thesaurus qui était le
fidèle compagnon d’écriture du père
du Petit Oiseau blanc.
«Émotif d’une manière affectée ou outrée.
» L’émotion y est donc surjouée, ce
qui est une autre manière de mise à distance, qui
participe de l’ironie et du jeu (et l'absence de cette émotion imitée). La sentimentalité
de Tommy n’est que sa croyance dans le masque qu’il
crée aux frais de sa propre personnalité. Elle fait
de lui un écrivain, elle le détruit en tant qu’homme.
Mais aurait-il pu exister en tant qu’homme indépendamment
de l’écriture (des masques) ? On peut poser la même question
au sujet de Barrie. Geduld écrit ces lignes qui nous paraissent
très lucides : «Ironiquement, la représentation
de lui-même par Barrie dans le personnage de Tommy est un
masque de plus, ajoutés à ceux que porte Tommy et
arrachés par son créateur. L’implication personnelle
de Barrie dans ses romans l’empêche de considérer
cela avec objectivité.» Le Capitaine W—, lui, surpasse
ce clivage à l’extrême fin du roman, puisqu’il
se révèle. Mais il n’en demeure pas moins
seul, bien qu’il ait l’espoir un peu fallacieux de
trouver quelqu’un qui reçoive son affection.
Tout le problème du sentimental est celui du rêve. Le rêve de soi, le rêve des autres...
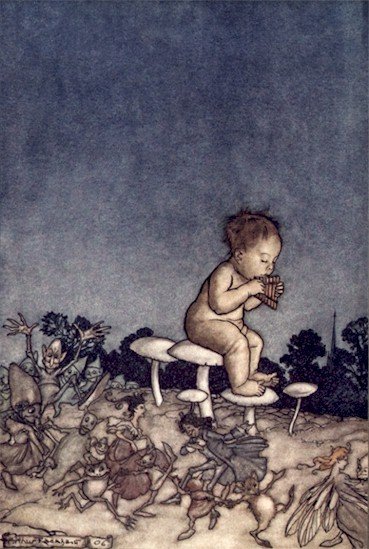
(Copyright Arthur Rackham)
Qui d'entre nous possède assez de
foi pour réaliser ses rêves ?
Tout le monde rêve.
Il n’y a pas d’âge.
Mais est-ce que ce sont les mêmes rêves, à
dix-sept et à quatre-vingts ans ?
Personne ne croit que les rêves ont une durée de
vie limitée.
Pourtant, c’est le cas. Ce n’est pas tout à
fait vrai, mais ça revient au même. Ce sont les gens
qui deviennent trop vieux pour les rêves. Comme un vêtement
qui aurait rétréci, ils ne peuvent plus les porter.
La vieillesse est moins une évidence physique ou une décision
qu’une possibilité qu’adopte l’homme
fatigué, qui s’aperçoit qu’il ne sera
pas celui qu’il a rêvé d’être et
qu’il est tentant d’aimer un bonheur simple, ordinaire,
facile, à portée de main et d’espoir. Pourquoi
ne peut-il être ce qu’il a rêvé d’être
? Parce qu’il a rêvé de travers ou bien parce
qu’il a volé le rêve de quelqu’un d’autre
?
Les enfants reprochent à leurs parents de n’avoir
pas (eu) le courage de réaliser leurs rêves.
Ils s’insurgent contre l’idée que leurs rêves
présents aient quelque chose à voir avec les rêves,
morts, de leurs parents. Ne dites jamais à un enfant qu’il
vous rappelle ce que vous étiez au même âge.
Il pourrait vous tuer pour ça et il ne serait pas à
blâmer. Il ne peut vous croire, quand bien même il
s’appliquerait à cet effort, car il est soumis à
son rêve, jeune maître du royaume des possibles qui
regarde avec condescendance le serf du monde des rêves perdus.
Pourtant de lui à vous, ce sont les mêmes rêves.
Décalés, ayant sauté une génération,
ils se retrouvent dans un corps et un esprit presque neufs. L’erreur
commune et répétitive serait de croire que le rêve
que l’on formule est inédit. Il n’y a pas un
million de rêves différents ni même une centaine.
Il y a trois sortes de rêves. Pas une de plus. Les rêves
au passé (les regrets et les remords), les rêves
au présent (l’espoir) et les rêves au conditionnel
(les rêves auxquels on ne croit pas mais qui sont agréables,
et qu’on habite, en passant, comme lorsqu’on s’arrête
à l’hôtel et que l’on fait semblant d’être
chez soi). Les songes ressemblent aux galettes des rois : il y
a toujours une fève à l’intérieur.
Tout le monde devrait la trouver, tout le monde a sa chance, mais
ça n’arrive presque jamais parce que les grandes
personnes sont trop sérieuses et qu’elles préfèrent
ne pas risquer de se tromper, d’échouer, alors elles
font mine de ne pas tenir à leur rêve.
La mémoire ne rétrécit pas avec le temps,
c’est l’inverse. Elle ressemble à un chewing-gum
frais que l’on a l’impression de pouvoir étirer
à l’infini. Il n’y a pas indigestion de souvenirs,
d’actes manqués et de rendez-vous annulés.
En réalité, ce sont tous ces moments perdus qui
prennent plus de place et qui nous dissuadent de nous ouvrir davantage
à l’univers, d’entasser de nouveaux visages,
d’engranger des idées inhabituelles ou d’inaugurer
des moments différents. On sait que ça ne sert plus
à rien, un peu comme les tas de livres qu’on achète
et qu’on empile, jusqu’au jour où on se rend
compte qu’on ne vivra pas assez longtemps pour tous les
lire. Alors à quoi bon en acheter de nouveaux ? Il se produit
un phénomène comparable avec les êtres et
les choses. On arrête d’aimer et de retenir les gens.
Certaines personnes, bien sûr, ne se rendent pas compte
de cette impossibilité. Elles continuent d’entasser
et puis un jour elles meurent sans avoir eu le temps d’apprécier
un peu ce qu’elles avaient.
Pourquoi oublie-t-on parfois ses rêves au réveil
? On les égare dans notre cerveau, à la manière
dont les parents du Petit Poucet on perdu leur fils dans la forêt.
Sauf que les rêves ne reviennent jamais si on a définitivement
renoncé à eux. Ils ont été adoptés
par d’autres personnes et c’est trop tard pour les
rattraper. Il n’y a rien de plus susceptible qu’un
rêve.
Les gens n’assument pas toujours les actes qui leur échappent
et ils parlent de moments d’égarement. Ils ne reviennent
pas souvent en arrière. Les moments d’égarement
sont les jours de permission ou de sorties des rêves dans
notre monde. Ils sont tenus en laisse comme des toutous par leur
propriétaire. Seulement, ces derniers ne s’en rendent
pas compte.
Barrie est le maître des songes.

Sylvia Llewelyn Davies
|



